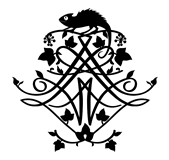Stratégies paysagères
interview michel desvigne
par hélène soulier et audrey contesse
Michel Desvigne retient du ‘paysagisme à la française’ l’approche du site et la manipulation des grandes structures végétales. Sa particularité réside dans une conception du projet qui privilégie une méthodologie scientifique et dans la nécessité du ‘voyage permanent’ qui l’amène aujourd’hui à travailler dans 14 pays différents dont la Belgique. Nous avons évoqué avec lui ses projets à Courtrai, Liège, Bruxelles, Gand et Anvers, sur lesquels il travaille avec Poponcini & Lootens, Stéphane Bell, ou encore Xavier de Geyter, mais aussi sa démarche et son dessin…
Les grandes reconversions territoriales s’opèrent avec les architectes: parlez-nous de votre collaboration avec eux.
Je travaille fidèlement avec un petit nombre d’architectes. Je côtoie deux générations d’architectes: la première compte Renzo Piano, Richard Rogers et Norman Foster, la seconde, c’est par exemple Xaveer de Geyter. J’ai énormément appris au contact des premiers qui ont une vision du projet assez voisine de la pratique scientifique expérimentale: on a une intuition, on émet une hypothèse, on teste l’hypothèse par le dessin et puis on la reformule. Le dessin est alors un mode d’expérimentation. Cette maîtrise du processus créatif m’apparaît encore plus nécessaire pour le paysage car les formes que l’on présente seront soumises à des mécanismes de croissance, de dégradation et de disparition, ceci nécessite une organisation rigoureuse de la créativité et de la pensée. La nouvelle génération, influencée par Rem Koolhaas, ajoute à cette rigueur expérimentale un jeu avec l’arbitraire: on teste des solutions sans a priori, on cherche tout azimut en quelque sorte.
Vos démarches sont-elles complémentaires?
Nos compétences se croisent et se superposent: un regard contredit l’autre qui fait évoluer le premier. Je choisis les architectes avec lesquels je travaille, aussi y a-t-il des complicités et des connivences, je partage avec eux des points de vue, des valeurs, et des recherches plastiques communes. Par contre, ma prise en compte de l’échelle est très différente. Nous, paysagistes, avons une capacité à lire l’échelle des sites que les architectes n’ont pas. Pour un architecte, passer de milliers de m² aux milliers d’hectares n’est pas évident. De notre côté, nous avons un entraînement à prendre la mesure de vastes territoires mais aussi une sensibilité aux milieux vivants qui sans doute nous permet de mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre dans les paysages.
Vous considérez-vous comme l’interprète de ces grandes échelles auprès des architectes?
Prenons le cas de Burgos. Herzog & De Meuron ont travaillé près de deux ans sur ce site: un faisceau de voies ferrées de 9 km de long qui va être désaffecté. La commande consiste à dégager 180 hectares pour développer la ville. Les architectes n’avaient peut-être pas pris toute la mesure des potentialités du territoire, bien qu’ils aient imaginé un remarquable développement du bâti. Mais le gigantesque espace vacant entre les constructions demeurait indéterminé, ou plutôt l’aménagement du vide ne me semblait pas être à la bonne échelle. Je suis intervenu en introduisant l’idée de créer une très grande structure végétale qui deviendra une ossature pour la ville. J’ai donc insisté sur ce qui me semblait être une nécessité: avoir une continuité physique de 9 km.
Qu’en est-il de vos productions belges?
Nous avons actuellement sept projets en Belgique qui sont essentiellement publics. On sent que tout est en germe, même si les moyens ne sont pas encore là, et qu’une commande publique éclairée pourrait s’épanouir dans les années à venir.
Il faut déjà souligner le cas de Courtrai, où la commande publique est très bien dotée et n’a rien à envier à la commande publique française. La ville d’Anvers est un autre exemple. Elle a de très forts comités de pilotage, sur le modèle néerlandais des ‘quality team’, qui se caractérisent par une grande qualité architecturale. De nombreuses réflexions ont été engagées à l’échelle du territoire. On peut citer les espaces publics du port le réaménagement de l’ancien hôpital militaire avec Stéphane Beel et Achtergael et les travaux sur le Middelheim. C’est une commande ambitieuse pour laquelle la conscience et le désir de retisser de grands territoires sont présents alors que, paradoxalement, les moyens sont faibles. Ceci nous amène à inventer des solutions et des écritures élémentaires et fortes, et nous contraint à une rigueur et à un certain détachement. Je ressens en Belgique une forme de modernité authentique et joyeuse qui stimule et nourrit ma recherche paysagère.
A quels types de commande êtes-vous confrontés?
Au-delà des commandes existantes, je ressens comme une nécessité impérieuse, comme le désir d’agir sur les territoires habités que produit la société contemporaine. Il est délicat de les nommer: suburbs, sprawls, périphéries. Ce sont des villes en gestation qui manquent souvent cruellement de lisibilité, de détermination ou plus simplement d’architecture. Ces villes n’apparaissent pas comme le produit d’un projet. Nous sommes en situation de les transformer, de leur donner les qualités spatiales qu’elles n’ont pas. Si l’on se réfère aux termes désuets mais intrigants des pratiques du XIXe siècle, nous sommes en situation de les ‘embellir’.
A Bordeaux, par exemple, nous avons convaincu tout le monde de créer un parc de 150 hectares au bord de la Garonne qui va devenir l’ossature de la ville. Nous avons un projet à Lyon-Confluencesur 150 hectares de développement.
Un autre thème, qui me fascine, est de travailler sur le développement des villes nouvelles en France. Ces villes disposent de gigantesques réserves de surface pour leur développement, comme à Cergy-Pontoise, par exemple, qui compte 2.000 hectares pour moins de 200.000 habitants…
Ces périphéries m’apparaissent comme l’accumulation cynique de besoins individuels, sans détenir la beauté violente des villes des pays en voie de développement, pour la simple raison qu’elles sont presque toujours contrôlées et organisées par des règles et des projets urbanistiques et rarement par une vision physique, architecturale. Il leur manque toujours un corps commun, une ligne d’horizon commune.
Comment le paysage intervient-il dans vos projets de reconversion territoriale?
Il n’y a pas de page blanche dans le territoire. Le projet joue avec ce qui est déjà là et s’installe nécessairement sur des traces. Dans le cas des reconversions territoriales, les parcelles se libèrent les unes après les autres et j’en profite pour fabriquer un paysage progressif. Le processus génère des formes: des lanières, par exemple, qui vont donner un cadre physique pour les quartiers à venir. C’est ce que j’appelle ‘la nature intermédiaire’. Ma démarche donne ainsi un statut à ce territoire en attente, territoire impliquant des réalités historiques, des structures géographiques et architecturales. Le paysage est, à mon avis, cet outil intermédiaire servant à transformer le territoire et à accueillir le futur. Dans ce sens, quelques villes américaines du XIXe siècle, comme Boston, Chicago, Minneapolis, avec leurs vastes systèmes de parcs, leurs puissantes ossatures paysagères sont des références pleines d’espoir et d’une actualité évidente.
Vous créez des milieux particuliers quand vous traitez la petite échelle: quels sont leur rôle?
Je considère les projets à petite échelle comme des prototypes, comme les laboratoires des projets territoriaux, et des lieux d’expérimentation sur le végétal. Bien sûr, on y a déjà aligné des arbres comme on aligne des lampadaires, mais j’ai peu de goût pour l’ornementalisme. Le fait de mettre un arbre rouge à côté d’un arbre jaune ne m’émeut guère. Le cas du projet de la forêt australe installée au ministère de la Culture à Paris est tout autre et proche de mes aspirations. Patrick Blanc et moi-même sommes partis d’une situation contraignante et d’un constat simple: les conditions de lumière d’une cour parisienne sont celles d’un sous-bois de forêt australe. On y trouve aussi peu de lumière que sous les très grands arbres et il y fait aussi froid. Or, sous la canopée, le sous-bois est d’une très grande richesse. La diversité et la qualité des végétaux sont spectaculaires: floraisons multicolores toute l’année, finesse des textures, feuillages persistants. La tentation était grande de ne pas se cantonner à l’acclimatation de quelques spécimens, mais de réaliser la miniaturisation de ce milieu vivant. Au-delà du travail du botaniste, il s’est agi d’un véritable travail de composition pour faire co-exister 1.500 plantes de 100 espèces différentes dans 170 m² en donnant l’illusion d’un milieu vivant. Nous avons procédé par étages, 12 au total, jouant des textures, des matières et des couleurs. On obtient un plan de plantation singulier qui superpose toutes ces strates avec une incroyable densité. L’expérience est toujours en cours et ouvre, à grande échelle, la perspective de nouveaux types de territoires. Il ne s’agit pas d’une écologie conservatrice, protectionniste, mais d’une écologie créative, instrument de l’architecture du paysage.
Une écologie créative?
Ce processus d’adaptation va, pour des raisons climatiques, bientôt relever de la nécessité. On sait que les probabilités pour que le climat change sont très fortes. Les forestiers, par exemple, travaillent sur ces prévisions depuis quelques années déjà. Dans mon cas, ces données me poussent à l’expérimentation. Planter ce qui poussait là n’a plus de sens aujourd’hui. Il faut planter des espèces qui sont adaptables aux conditions que l’on a en ce moment, mais aussi à celles qui pourraient arriver si elles évoluent. On ne peut plus raisonnablement se référer à un état idéal permanent, le recours à un état initial n’a plus de sens.
Avez-vous un jardin?
Non, et je ne suis pas sûr d’en vouloir un. Je voyage en permanence et je ne m’imagine pas dans un jardin personnel.
Par contre, ma vie a été liée à trois jardins publics: le parc de Versailles, le jardin de la Villa Medicis à Rome et le jardin des Plantes à Paris. Ce sont des lieux que j’ai tour à tour fréquentés presque quotidiennement. Je réalise à quel point ils sont importants: ils sont mes ‘jardins-étalons’. Voir le paysage existant, en percevoir l’échelle sont les conditions nécessaires des projets car sa réussite est plus liée à sa pertinence, à la justesse de son échelle, qu’à son écriture.
A quelle étape du projet allez-vous sur le site?
Pendant longtemps, j’entamais les projets bien avant d’aller sur les sites. Je pense que l’on voit les choses à partir du moment où l’on a déjà un questionnement. Trop d’analyses, même extrêmement intéressantes, ne mènent finalement nulle part, parce que l’on n’y décèle aucune interrogation. Si on ne cherche rien, on ne trouve rien. Si voir le site est un grand enjeu du projet, ce n’est pas s’y rendre béatement, c’est y aller avec un besoin, une tension, des nécessités. La réalité est tellement complexe qu’elle nous noie. Parallèlement, aller sur le site signifie, pour moi, aller sur les sites. Je prends la mesure des lieux par contraste entre mes jardins-étalons et mes voyages permanents. Je connais les problématiques territoriales par accumulation d’expériences. Mon attitude est boulimique: 80 projets répartis sur 14 pays.
Retournez-vous fréquemment sur vos anciens projets?
Non seulement je retourne visiter mes anciens projets, mais mes missions sont extrêmement longues. Pour le cas de Montpellier par exemple, cela fait une quinzaine d’années que je travaille dessus, une bonne mission dure vingt ans. Les processus prennent du temps et la matière végétale est gérée sur un temps long. Dans une forêt de 100 jeunes arbres, il ne restera, à terme, qu’un adulte. Le travail consiste donc à choisir les 99 que l’on décide de ne pas conserver.
Vos anciens projets vous convainquent-ils encore?
Comme tout architecte, je suppose, j’éprouve une sorte de douleur face au travail arrêté, daté. Nos démarches progressent et ces œuvres témoignent d’étapes déjà dépassées. L’idéal serait d’éternellement les continuer et les reprendre.
Il y a cependant des plaisirs archaïques qui sont le privilège des paysagistes: voir que les arbres poussent, que la vie s’est installée, qu’un paysage se constitue… sont des satisfactions enfantines et intenses.
Pouvez-vous revenir à cette question du temps qui rend la pratique paysagiste singulière au regard des autres pratiques de la conception?
Il y a trois temps différents: en premier, le temps de la mode, en second celui de l’architecture, vient enfin le temps du territoire. Le temps de la mode est très fugace, il est intéressant mais ne reste pas. Le temps de l’architecture est plus lent mais les bâtiments sont datés à peine quinze ans après leur livraison, c’est une réalité. J’aime et je m’intéresse à cette vivacité et à cet éphémère bien qu’ils me soient étrangers. Nous, c’est trente ou quarante ans qui nous sont nécessaires. Un temps proche de celui des urbanistes mais qui est dicté par le milieu vivant. Nos architectures se conçoivent par stades successifs. Il n’y a pas d’état arrêté, pas d’état final ni idéal d’un projet de paysage. D’où notre intérêt pour les processus d’évolution, les stratégies de maîtrise du temps. Il m’est impossible de concevoir la ville autrement que comme un organisme vivant soumis au temps. Ma contribution à l’urbanisme est d’ailleurs de cet ordre: accompagner les mutations urbaines par des paysages évolutifs. Rendre explicites les temps de la ville.
Comment vos représentations cartographiques prennent-elles sens?
L’abstraction de la carte nous permet de voir: sans la carte on est noyé. D’où l’immense importance du travail graphique, avec tous les risques du formalisme que cela implique. La carte est un outil fantastique qui nous permet de voir une chose immergée dans la complexité du réel. On doit s’abstraire du réel à certains moments de la démarche sinon ce réel nous engloutit. Il faut passer sans arrêt de la réalité à un modèle abstrait et, de ce modèle, revenir à la réalité. Tous les moyens de représentations sont bons: les cartes, les maquettes… L’abstraction permet de comprendre, de trier, de choisir.
Comment votre dessin échappe-t-il à la tentation du formalisme?
L’outil graphique est à la fois un danger, une limite, mais il est aussi une condition nécessaire. Mon ambition est que le dessin soit un outil de conception, un outil de recherche et d’expérimentation sur l’espace. Il me permet, par exemple, de travailler les jeux de densités qui me fascinent. Un espace ni plein ni vide mais de densité variable. Je suis tout autant convaincu de l’importance de la détermination esthétique qui les fonde. Si le dessin est déterminé esthétiquement, il y a de grandes chances pour que le projet le soit aussi. C’est elle qui me guide pour dessiner ces vastes structures végétales, car il ne s’agit pas de nature mais bien d’artifice, d’architecture.